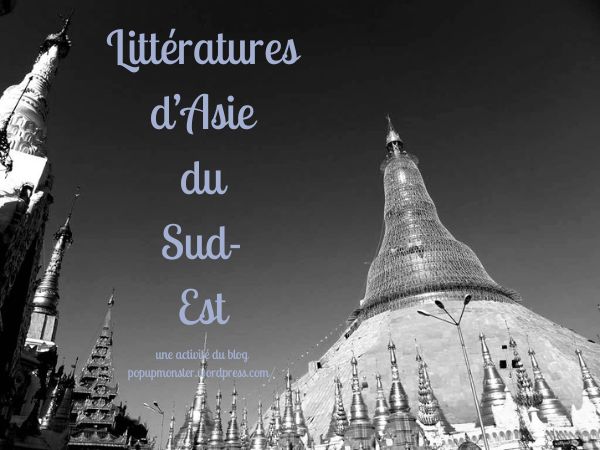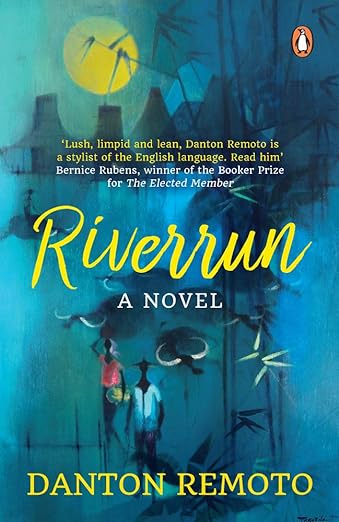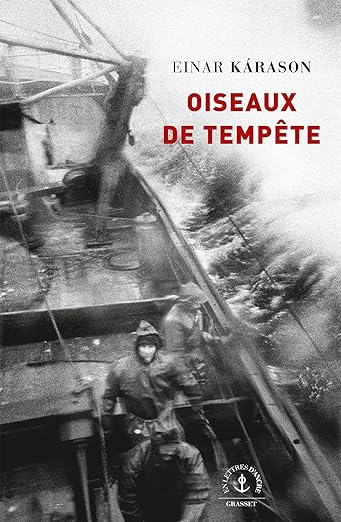Tan Twan Eng, The House of Doors: 1921 – Lesley Hamlyn vit avec son mari Robert, un vétéran de la guerre et avocat, à Penang (faisant partie à l’époque des Straits Settlements, ou Etablissements de détroits, administrés par les Britanniques). Ils occupent une maison en bord de mer nommée Cassowary House qui rappelle l’oiseau, le casoar (dont le nom vient du malais) mais aussi l’arbre, le casuarina, dont un exemplaire apporte de l’ombre au jardin. Un ami de longue date de Robert, Somerset Maugham (Willie), vient s’y installer pour un moment, avec son « secrétaire » Gerald. Les soirées sont l’occasion de discussions autour d’un verre et Lesley dévoile des secrets, tout en se rendant compte qu’ils serviront sans doute d’inspiration à l’auteur pour ses prochains écrits. On retourne alors au début des années 1910: Sun Yat Sen est en mission à Penang pour récolter de l’argent pour sa cause et Lesley le rencontre, ainsi que son groupe d’amis. A la même époque, la colonie est secouée par le procès d’une Anglaise accusée de meurtre; elle est une amie de Lesley et celle-ci fait tout ce qu’elle peut pour la soutenir.
L’auteur malais (qui écrit en anglais) Tan Twan Eng s’est inspiré d’événements réels: le séjour de Somerset Maugham à Penang (qui a inspiré son recueil de nouvelles The Casuarina Tree (Le sortilège malais)), celui de Sun Yat Sen en 1910 et le cas d’Ethel Proudlock qui a tué un homme en 1911 (je me suis rendue compte que c’est aussi le sujet du quatrième roman de la série autour d’Harriet Gordon d’A.M. Stuart, dont j’ai lu les deux premiers ainsi que du film The Letter avec Bette Davies que j’ai vu récemment, d’ailleurs adapté d’un roman de Maugham). L’auteur a joué avec les dates pour faire coïncider ces deux derniers événements en 1911.
Quand j’avais lu que ce livre parlait Maugham, j’avais été moins tentée par sa lecture et je l’avais repoussée. Je n’aurais pas dû. J’ai retrouvé avec un immense plaisir l’écriture de Tan Twan Eng, ses histoires très bien construites qui tiennent en haleine le lecteur, ses descriptions de la nature luxuriante de Penang et de la Malaisie, sa connaissance de la société coloniale mais aussi l’inclusion de beaucoup de notions typiquement malaises, des mots locaux, la cuisine, les ambiances… J’ai très vite accroché à cette histoire qui se déroule à plusieurs niveaux, la vie d’un auteur célèbre aujourd’hui alors qu’il est dans une passe difficile, son homosexualité dont il ne faut pas parler, ainsi que la vie de la communauté chinoise de Penang et pour pimenter le tout, une histoire de meurtre et de procès. C’est un roman qui parle de sujets contemporains comme la sexualité, le genre, les relations de couple, le racisme, le colonialisme mais en les remettant dans un contexte plus ancien. J’ai adoré !
Ce roman n’est pas encore traduit en français, mais je vous conseille chaudement la lecture de deux romans plus anciens, Le don de la pluie (The Gift of Rain – 2007) et Le jardin des brumes du soir (The Garden of Evening Mists – 2011). Ces trois livres s’insèrent dans l’activité sur les littératures d’Asie du Sud-Est.
Tan Twan Eng, The House of Doors, Bloomsbury Publishing, 2023, 320p. (pas de traduction en français, mais ça pourrait bien être prévu)