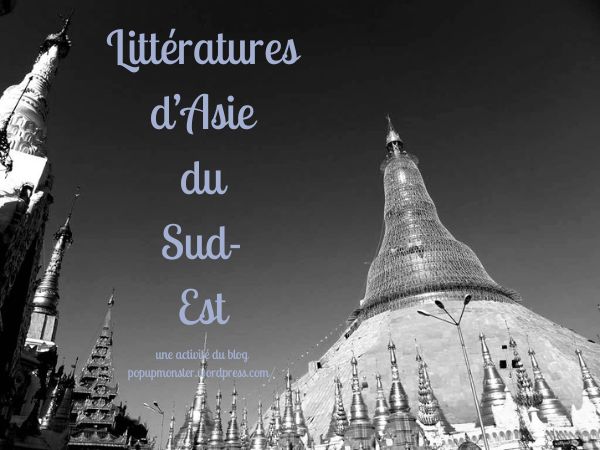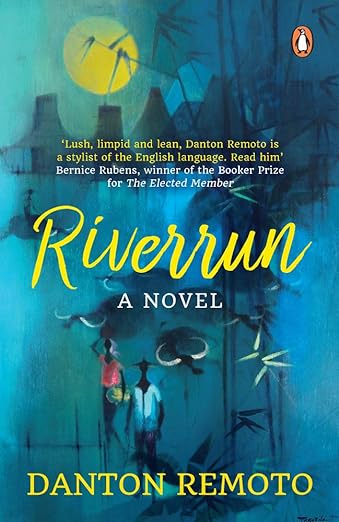Lundi: une nuit d’insomnies et de maux de ventre, des règles tellement fortes et une fatigue tellement importante que je préfère me déclarer malade aujourd’hui – utilisons donc un de ces jours de maladie sans certificat – ce sera vraiment nécessaire, me lever et avoir envie de me remettre au lit de suite, une belle crise de larmes pour cause d’épuisement et cette impression d’avoir de nouveau 14 ans, le mail au gynécologue qui restera sans réponse – il est en vacances – et donc décider de reprendre la pilule – un moindre mal je pense par rapport aux trois solutions possibles (THS, rien ou pilule donc), le soutien d’une amie, des courses nécessaires pour refaire un stock de protections, traîner toute la journée et essayer de dormir un peu, de la lecture mais aucune concentration, de tout et n’importe quoi à la tv
Mardi: pas mieux, mais je ne dois bien aller au bureau aujourd’hui (je ne vais quand même pas déranger mon médecin pour un certificat pour ça), plein de petites choses à faire et à terminer, mais le gros truc c’est d’organiser la nouvelle page d’accueil du site avec un collègue, le soutien des collègues-amis quand je leur touche un mot des mes soucis, m’affaler dans le canapé une fois rentrée, mais quand même avoir le courage de regarder la fin du film qui pourtant n’est pas des plus faciles ni joyeux: Torment (Alf Sjöberg, Suède, 1944)
Mercredi: youhou – une bonne nuit et ça va tout de suite mieux, et puis reprendre la pilule était sans doute la meilleure idée – on verra dans les mois qui viennent si je retrouve un certain équilibre, et une journée de télétravail à la veille d’un long w-e, un premier livreur qui arrive quand je suis encore en pyjama, écrire des textes et continuer de terminer des choses sur la to-do list, la postière qui est d’une gentillesse incroyable – ça change des livreurs pressés et désagréables, terminer un livre et choisir le suivant, de la cuisine, le début d’un film, apprendre le décès de Steve Albini et repenser à tous ces disques que j’aime
Jeudi: il y a plein de brouillard, l’expédition sur les routes flamandes, revenir avec plein de nouvelles plantes exotiques, rempoter les anciennes – ce qui est un sacré boulot, de la lecture, la fin du film: The Devil’s Advocate (Taylor Hackford, 1997)
Vendredi: un jour de congé pour faire le pont, le grand soleil dès le matin, de la couture, arranger les plantes en pot sur ma terrasse, semer les ipomées – enfin !, de la lecture sous le parasol, abandonner un livre de non-fiction et râler sur la piètre écriture d’un autre, le début d’un film
Samedi: un début de matinée paresseux, et puis m’attaquer à ce palmier mort tant qu’il est encore à l’ombre, j’ai dû insister un peu mais j’ai réussi à le déterrer, planter autre chose à la place, encore quelques menus travaux de jardin mais très vite m’installer sous le parasol avec des livres, profiter pleinement du beau temps, regarder le début de l’Eurovision mais à vrai dire ça m’ennuie un peu
Dimanche: traîner beaucoup, faire des recherches qui ne mènent pas à grand-chose, de la lecture au jardin, la pluie qui arrive subitement et qui met à l’eau tous mes plans de barbecue – j’aurais dû le faire hier mais j’ai fait confiance aux prévisions météo, la reprise de la pilule était la meilleure idée de la semaine et je me sens enfin bien, la fin du film: Poor Things (Yorgos Lanthimos, 2023)
sur suasaday, je quitte Hong Kong pour arriver à Bangkok.